Psaumes de la foi vive, de Gérard Bocholier
Psaumes de la foi vive
Gérard Bocholier
Ad solem, 2019
J’écris en songeant que l’ombre
Gagne les papiers la table
Bientôt la main qui se crispe
Et l’âme en son labyrinthe
Mais je sens sur mon épaule
Ta main d’amour qui me touche
Et la chambre est visitée
Alors d’un semis de roses
Les Psaumes de la foi vive constituent
le quatrième recueil de psaumes de Gérard Bocholier1
ou le cinquième si l’on intègre à l’ensemble le recueil que le
poète publie au même moment chez Arfuyen, Depuis toujours le chant.
Cette association du psaume – dont la tradition en français
remonte à Marot2
– et du chant n’est pas fortuite.
Il y a, en effet, une vocation
spirituelle de la modernité poétique. Elle tient probablement au
contexte philosophique et socio-politique dans lequel cette modernité
s’impose. Les 18ème et 19ème siècles vont progressivement mais
radicalement défaire les liens communautaires par lesquels
l’individu se rapportait à lui-même et aux autres, pouvait se
penser, vivre son identité, son devenir, donner un sens à l’horizon
mortel qui fait la condition humaine. Au moment où la subjectivité
semble s’éveiller à elle-même, elle se découvre également
exilée des verts paradis de l’enfance, ayant perdu définitivement
cette naïveté qui était celle des premiers âges, vouée à n’être
plus que sentimentale, c’est-à-dire réflexive, traversée
d’échos, jamais tout à fait à elle-même, toujours au-delà ou
en-deçà d’elle-même. Le Romantisme s’inscrit à la croisée de
ces tensions et il est peut-être – du moins depuis l’antiquité
– le premier mouvement littéraire à proprement parler non pas
seulement parce qu’il produit une littérature qui s’est donné
ses propres règles et horizons esthétiques, non pas seulement parce
qu’il se sait produisant de la littérature – c’est-à-dire un
type d’écrit autonome, proprement social qui participe à sa
manière et pour un temps à la manifestation de l’Esprit – mais
parce qu’il investit dans cette production une quête du sens qui,
à tout moment, bute sur mais aussi s’avive du tissu discursif qui
voile notre rapport à ce qui est ou à l’être. L’individu
romantique – et avec lui, le poète moderne – se sait un être de
paroles, il sait que sa présence au monde et à lui-même se trame
d’un infini discursif qui, tout autant que celui qui angoissait
Pascal, recèle un profond silence où l’âme s’abîme. Qu’on
songe à l’exclamation qui ouvre le poème intitulé « Foi »
de Lamartine dans les Méditations poétiques : « O néant
! ô seul Dieu que je puisse comprendre ! ». Qu’on relise les
vers qui suivent et qui posent la question du sens de la condition
humaine :
Silencieux abîme où je vais
redescendre,
Pourquoi laissas-tu l'homme échapper
de ta main ?
De quel sommeil profond je dormais dans
ton sein !
Dans l'éternel oubli j'y dormirais
encore ;
Mes yeux n'auraient pas vu ce faux jour
que j'abhorre,
Et dans ta longue nuit, mon paisible
sommeil
N'aurait jamais connu ni songes, ni
réveil.
Ce faux jour – au sens où il est
trompeur, où il n’éclaire que faiblement et en définitive nous
trompe sur ce que serait le jour véritable, la pleine lumière, la
pleine connaissance – est celui auquel l’homme de la modernité
se découvre voué, écoutant en vain, comme le dit encore Lamartine,
« les sages de la terre » au concert desquels se sont
ajoutées de multiples voix : rationalisme scientifique,
matérialisme encyclopédique, pragmatisme, illuminisme, bientôt
nihilisme, etc. Il se sait pris dans le labyrinthe de l’esprit qui
lui laisse bien entendre l’écho de l’Esprit, qui bruit de
discours où raisonne l’écho de la Parole, qui lui indique bien le
chemin mais pour l’abandonner au premier croisement, le laissant
seul maître et seul responsable de son choix. La veine comique –
au sens Rhétorique de ce terme – saura faire son miel de cette
situation. Les grands romans du 19ème siècle en naîtront qui
renouvellent à leur façon la figure de Don Quichotte. Le lyrisme,
quant à lui, cherchera bien souvent à l’approfondir, et échappant
à l’ironie, à lui trouver une issue. Paradoxalement, en creusant
le vers et en y rencontrant le néant comme en fera le constat
Mallarmé, la modernité poétique a donné tout son sens à la
position paradoxale du sujet face au monde. Elle l’arrache à
l’individualisme comme au conformisme, à cette prose universelle
où il s’englue sans pour autant le contraindre à rejoindre la
tribu et ses mots épuisés. L’aventure poétique devient celle
d’un seul comme l’est celle du mystique qui répond à l’appel
et fait face – et bien souvent plie face – à ce qui le dépasse.
Elle devient exercice spirituel en ce sens où elle témoigne d’une
transformation, d’un chemin parcouru, d’un possible maintenu face
à ce qui semble nier tout possible. On a pu reprocher à cet
exercice de solitude ou à la solitude que devient la poésie tout au
long du 19ème siècle d’avoir confondu recherche de l’originel –
approche d’une fondation absolue du sens - et quête de
l’originalité. De l’une à l’autre se joue ce que l’on
appelle un sujet en poésie : moins celui qui dit je que celui
qui en son je accueille ce qui le transforme sinon le défait comme
ipséité3.
Non plus le mur sur lequel se projette le monde en ombres chinoises
mais fenêtre qui ouvre sur le vol hirsute des martinets à la fin du
jour. « Une seule chose dans la poésie, écrit Joseph Joubert,
ne peut lui être dérobée, c’est sa lumière continue ».
Charles Journet – dont une citation ouvre le dernier recueil de
psaumes de Gérard Bocholier, Psaumes de la foi vie – lui fait écho
deux siècles plus tard : « jusqu’à la fin la
transparence devra grandir ; il n’arrivera pas d’instant où
nous puissions croire qu’elle est parfaite, mais c’est déjà un
grand signe de l’amour que de la désirer et de la mendier et
d’attendre avec une confiance infinie le jour où tous les voiles
seront déchirés. »
Bien sûr le destin de la poésie
moderne ne se réduit pas à ce lien originel avec la spiritualité
ou plutôt ce destin est tributaire des évolutions socio-politiques
et philosophiques qui ont marqué le 20ème siècle et notamment du
regard posé ou de la place laissée à l’individu en tant que
sujet. On pourrait résumer ces fluctuations à celle de l’humanisme
à la condition de ne pas voir en ce dernier une sorte d’optimisme
béat en l’avenir de l’homme et de ne pas oublier que la question
de l’autonomie, de la liberté ne se sépare pas dès l’origine
de celle de la Grâce ou encore, dans une version plus laïque,
quoiqu’inspirée de Pascal, du Pari. Et de fait, l’effacement au
début des années soixante ou du moins la relégation au second plan
de la poésie spiritualiste – qu’elle se réclame ou pas d’une
confession – et avec elle du lyrisme en général – qu’il dise
l’engagement politique ou seulement l’amour – cet effacement
coïncide avec la grande période en sciences humaines du
structuralisme ou encore en philosophie de la déconstruction. Cette
période – qui coïncide également plus ou moins avec le
développement de la société de consommation – remet en cause la
notion de sujet et celles qui l’accompagnent pour une vision
radicalement déterministe qui fait – pour aller vite – de la
conscience de soi ou du monde un effet du discours social. Pour
paraphraser Mallarmé et le détourner quelque peu, les penseurs de
cette période auraient pu affirmer que le langage a lieu et qu’on
ne saurait rien lui ajouter, mais seulement alimenter son
fonctionnement impersonnel ou nécessaire. Autant dire que, dans
cette perspective, il n’y a pas d’œuvre ni même d’acte par
lesquels un individu puisse se réaliser en tant que tel. Les années
quatre vingts vont progressivement sortir de cette impasse et revenir
au lyrisme, revenir au monde et à sa diction. Là encore les
conditions socio-économiques sont déterminantes : comment
continuer à se dire a-humaniste dans un monde mondialisé qui arase
et transforme en marchandise toute production humaine ? comment
continuer à déconstruire alors que la déconstruction et le
recyclage infini des discours sont devenus le ressort essentiel du
marché ? Que reste-t-il pour échapper au brouhaha que fait le
monde sinon le silence ou l’attention, l’écoute, l’accueil,
c’est-à-dire finalement tout ce qui définit le lyrisme moderne
dès ses origines ? Et il est très significatif que le deuxième
recueil de psaumes de Gérard Bocholier, Psaumes de l’espérance
soit précédé d’un envoi du grand aîné qu’est Philippe
Jaccottet qui dans la tourmente nihiliste des années soixante-dix a
su ne pas dévier son chemin. « Jean-Pierre Lemaire a bien
raison de louer vos poèmes », écrit-il à Bocholier, « ils
sonnent juste d’un bout à l’autre, ils disent des choses
délicates sans mièvrerie, des choses graves sans peser jamais. Ils
accompagnent le lecteur avec une ombre amie, discrète ; et
voilà que cette ombre est quelque chose comme Dieu ; ce qui
émeut même le douteur ! »
Chacun des termes
de ce bref envoi mériterait une attention particulière. Ce que
relève Jaccottet, c’est d’abord une capacité à dire, à faire
entendre à nouveau, faudrait-il ajouter, ce que deux siècles de
poésie avaient peut-être rendu inaudible. Non que le langage de
Bocholier soit novateur. Bien au contraire, il reprend des images et
des symboles très anciens et leur donne ou leur re-donne, par la
justesse de sa voix – notion importante pour Jaccottet – tout
leur éclat. Et cette capacité à dire à nouveau, elle tient
d’abord à une attention aux signes et aux présences ou encore à
une attention qui transforme en signes les présences ainsi qu’à
une très grande simplicité, laquelle, bien sûr est celle du
matériau linguistique, mais aussi, et plus essentiellement, celle du
sujet lyrique lui-même. Ces trois éléments : l’attention,
la simplicité stylistique et celle du sujet lyrique qui est tout
entier à sa diction sont en interaction. La capacité à faire
affleurer une présence – Jaccottet parle d’une « ombre
amie » - à travers les présences du monde et à le faire sans
affectation qui affaiblisse l’intention ou qui trahisse une
faiblesse dans cette intention, c’est finalement le contraire de la
mièvrerie dont parle Jaccottet. De même l’esprit d’enfance et
de confiance ou d’espérance s’oppose-t-il à la puérilité qui
entre encore dans la définition du ton mièvre. L’esprit d’enfance
et de confiance est à l’horizon – qui ne cesse de reculer – du
labeur intérieur qui produit la simplicité ou plutôt qui prépare
l’individu à l’accueil de ce don ou de cette grâce. Un recueil
de psaumes comme celui de Gérard Bocholier témoigne de cette
réforme intérieure et de cette tension vers un point critique où
l’individu s’abolit pour s’accomplir4,
pour laisser affleurer tout autre chose que lui, un monde d’abord
où il puisse prendre place et « quelque chose comme Dieu »
qui puisse l’accompagner dans son chemin, en éclairer la part
d’ombre. Il témoigne également de l’inscription de ce travail
dans une durée que les poèmes détaillent en autant d’instants
qui tendent vers un unique foyer. D’où, peut-être, un effet de
monotonie et de répétition qui construit une temporalité qui est
tout à la fois celle de la prière et celle de l’imminence.
Remettre sur le métier ou reprendre toujours à nouveau le même
chemin, il y a là un autre point commun entre la poésie et la
spiritualité qui, par définition sinon par essence ne sont assurées
de rien et qui n’ont l’une et l’autre pour se rassurer que
quelques pauvres signes qui les renvoient à une précarité
essentielle, le vent, l’herbe ou encore le souvenir d’une
empreinte, autant dire bien peu de choses :
Si le vent nous abandonne
Les brins d’herbe auront encore
Pour veiller sur nous des larmes
Un chant secret tissé d’ombre
Si je te perdais en route
Comment oublier l’empreinte
De ton aube au front d’épines
Ton flanc incendié de roses ?
E.D.
1Chez
Ad Solem, déjà : Psaumes du bel amour (2010, avec une
préface de Jean-PierreLemaire), Psaumes de l’espérance
(2012, avec un envoi de Philippe Jaccottet) et Nuits (2012).
2Voir
à ce sujet du même poète, chez Ad Solem, en 2014, Le
poème, exercice spirituel.
3Cette
note par laquelle Gérard Bocholier ouvre son essai sur la poésie
comme exercice spirituel : « Pierre Reverdy nous désigne
« celui qui cherche/ plus grand que ce qu’il cherche ».Toute
écriture poétique n’est-elle pas exercice spirituel, dans la
mesure où le travail de la langue est aussi travail sur soi-même,
dans aussi où, plus ou moins confusément, le poète sait qu’il
doit s’effacer devant quelque chose – ou quelqu’un – de plus
grand ou de plus fort que lui ? »
4Voir
ce qu’écrit Louis Lavelle dans L’erreur
de Narcisse
(Grasset, 1939/ La Table Ronde, 2003, p.201) : « Le signe
même de la grandeur, c’est d’avoir su réaliser en soi ce vide
intérieur, ce parfait silence de l’individu, c’est-à-dire de
l’amour-propre et du corps, où tous les êtres entendent la même
voix qui leur apporte une commune révélation. Ce silence, les
choses les plus grandes à leur tour ne manquent jamais de les
produire. // La conscience la plus pure est toujours la plus
transparente. C’est dans une abdication de soi où toutes ses
puissances paraissent s’abolir que l’individu se réalise, qu’il
sent naître cette confiance intérieure qui lui permet de croître
et de s’accomplir. Et c’est quand l’attention est la plus
docile et la plus fidèle, que l’action est la plus personnelle et
la plus efficace. »
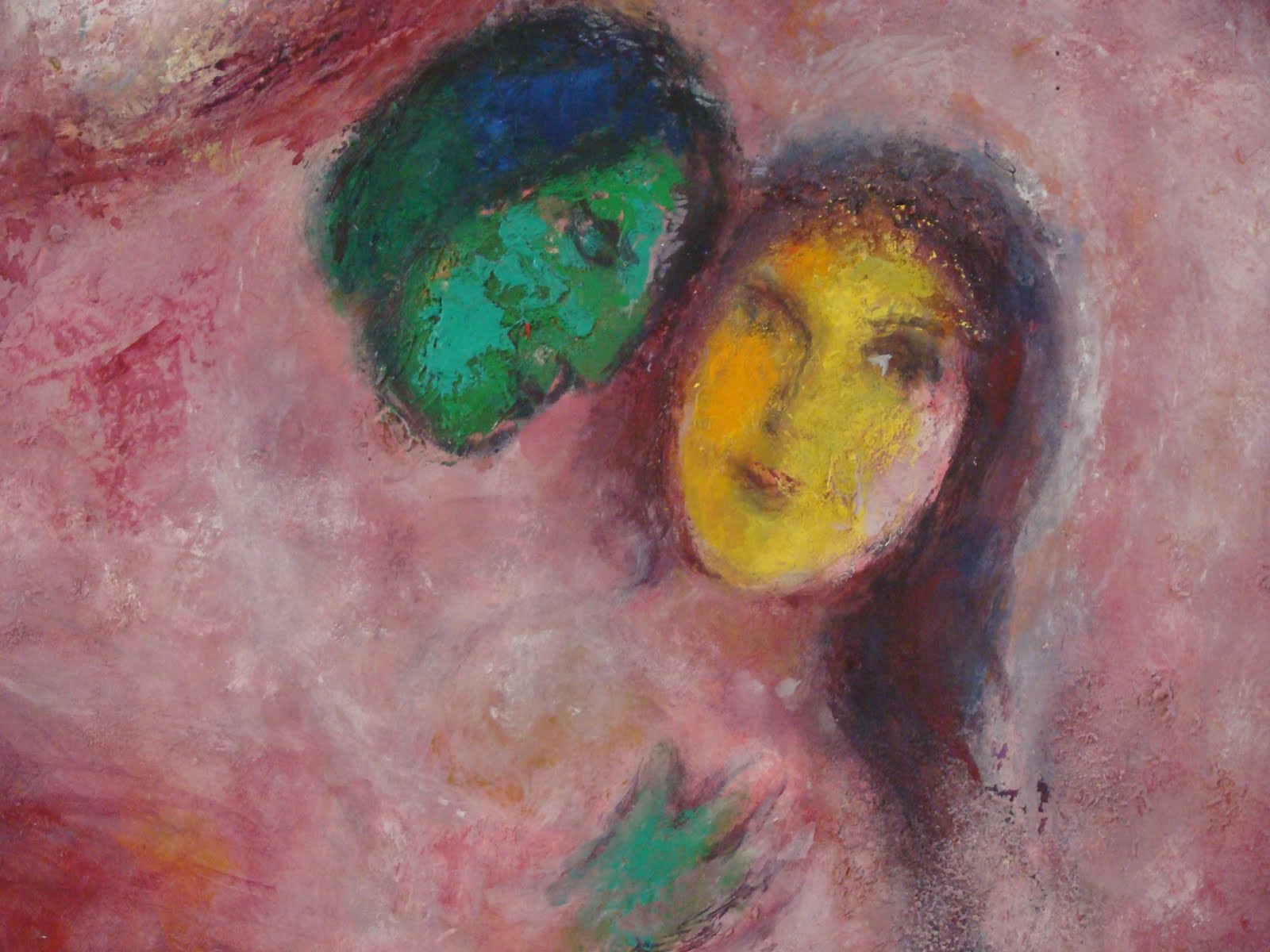 |
| Marc Chagall |


Commentaires
Enregistrer un commentaire